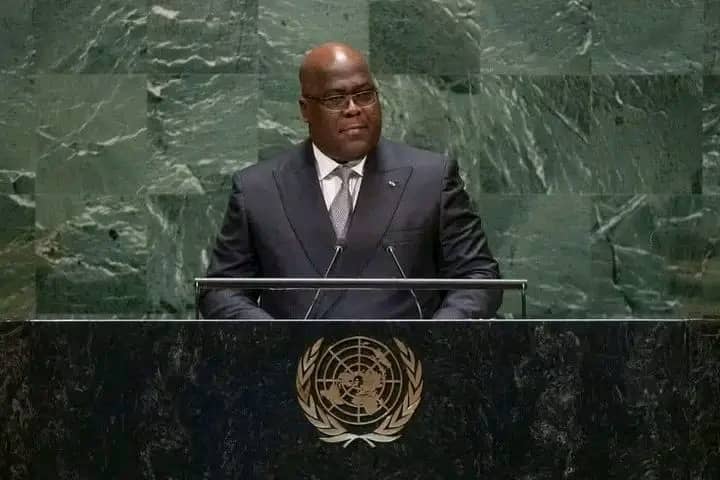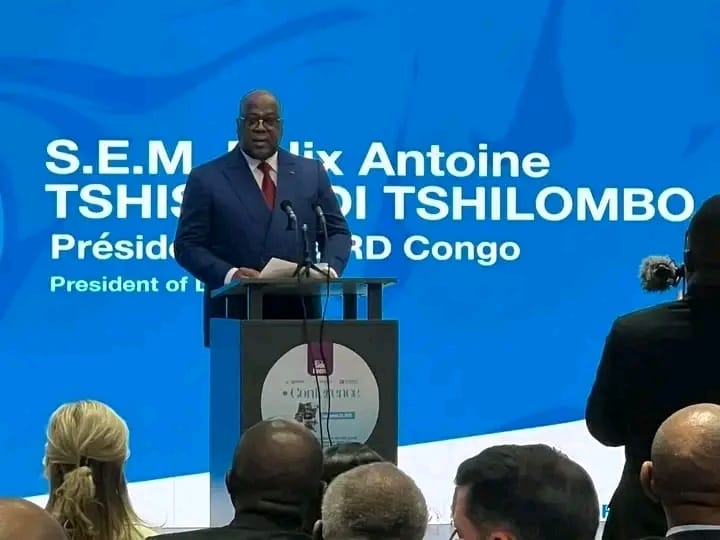La dot, autrefois symbole d’engagement et d’honneur, est devenue une source de préoccupation pour de nombreux jeunes en République Démocratique du Congo (RDC). Alors que la pratique évolue, les attentes en matière de dot se sont intensifiées, transformant ce qui était un rite d’amour en un obstacle financier.
Traditionnellement, les familles demandaient des objets simples, comme des vélos ou des foulards de tête, ainsi qu’un montant raisonnable. Ces exigences permettaient aux jeunes couples de se marier sans trop de difficultés. Aujourd’hui, cependant, les attentes se sont intensifiées. Les demandes incluent désormais des biens matériels tels que des télévisions, des perruques de 130 pouces, des motos à la place des vélos, et un montant exorbitant. Cette modernisation rend le mariage inaccessible pour beaucoup, ajoutant une pression financière considérable.
Les points de vue sur cette évolution sont partagés. Pour certains, la modernisation de la dot est perçue comme un signe de progrès, reflétant les aspirations contemporaines et adaptant les traditions aux réalités économiques. En revanche, d’autres estiment que ces nouvelles attentes déforment l’essence même de la tradition, rendant le mariage plus difficile à atteindre pour de nombreux jeunes.
Taylor Mandungu, un jeune Congolais, suggère que l’État fixe un prix de dot concret. Selon lui, cela pourrait aider à limiter les demandes excessives des familles et encourager les jeunes à prendre des initiatives matrimoniales, surtout dans un contexte économique précaire. Il déclare : « Il est nécessaire que l’État congolais propose un prix concret de dot et des biens matériels à donner selon les traditions de chaque tribu. »
La question de la dot en RDC soulève un débat crucial entre héritage traditionnel et pressions contemporaines. Si certains voient ces changements comme une évolution positive, d’autres appellent à une réévaluation des attentes afin de rendre le mariage accessible à tous.
Caroline kaja